Dialogues 42# samedi 20 septembre 2025: "Dès la terre": Garder le paysage: conversation avec 4 ingénieurs agronomes.

-
Présentation des invités
Nous recevons aujourd’hui 4 ingénieurs agronomes pour la présentation de leur film intitulé “Dès la terre”, réalisé pendant leur année de césure en école d’agronomie. Anciens étudiants de l'ENSAT Toulouse, aujourd'hui ingénieurs agronomes, Marguerite Arnedo-Baptiste Dubuet-Julie Poisson- Marie Saliou viennent de plusieurs régions de France pour rendre compte de ce travail de création et d'information de pratiques agricoles souvent peu connues ou invisibilisées.Issus du milieu paysan ou pas, ces jeunes actifs, tout juste diplômés en agronomie, nous parlent des enjeux de l'agriculture en France et de la responsabilité de chacun pour préserver tout à la fois les modèles traditionnels mais aussi l'adaptation et la modernisation nécessaires à une meilleure valorisation des espaces et des paysages agricoles. Leur film amateur, disponible en lien you tube, propice aux échanges après visionnage, propose une tournée créative dans les fermes du sud de l'Europe pour vivifier les rencontres humaines au plus près de la terre qui nourrit l'Homme, saisir les enjeux écologiques contemporains et la nécessité du débat démocratique pour l'usage de techniques appropriées de valorisation des sols et des cultures.
L’origine de cette émission tient, comme toujours, à une rencontre hasardeuse et aux partages de textes pour lancer la discussion et partager un questionnement commun. Quels sont les moyens que les petites exploitations se donnent pour faire face au réchauffement climatique et aux politiques agricoles européennes? Quelle solidarité s'y expérimente ? Quelle liberté est donnée à chacun dans le choix de ses cultures? Que signifie garder un paysage?
2)La représentation romantique de l’agriculture? Qui garde la terre?
-A partir de la lecture de la démocratie aux champs de Joëlle Zask, quelle lecture peut-on faire des 20 témoignages recueillis dans le film? En quoi les fermes visitées témoignent-elles de la solidarité des campagnes et de l’auto-organisation et coopération qui président aux choix et/ou à l’abandon de certaines cultures et de rendements?
-Introduction de la démocratie aux champs J.Zask
“Les conceptions, toujours vivaces, du paysan soit comme ce personnage authentique, simple et vertueux que dépeint le romantisme, soit comme ce personnage généralement associé à la droite, arriéré et conservateur, dont la conscience n'irait pas au-delà des limites de son lopin de terre, matérialiste invétéré et égoïste, voire réactionnaire, qui n'a que haine pour la ville, la société, l'étranger et le progrès, commencent à refluer. À leur place s'ouvre un vaste domaine assez peu exploré où la culture cesse d'être contraire à la nature. Un cortège bigarré de conceptions et d'expériences qui, sans être universelles ou éternelles, n'en sont pas moins édifiantes et exemplaires se met à défiler sous nos yeux. Tout “commence”, si l'on peut dire, par le jardin d'Éden qui donne le ton: Adam, dit le texte biblique, doit « cultiver le jardin et, en même temps, le “garder” (shomer en hébreu, équivalent du care), c'est-à-dire en prendre soin. Comme à l'égard d'un enfant, cultiver c'est garder, garder, c'est cultiver. On entrevoit d'emblée le poids politique et écologique d'une telle combinaison, et, par contraste, la nature des conséquences auxquelles ont mené l'oubli, le déni, l'occultation de son importance cruciale. Lié à prendre soin ou conserver, cultiver la terre n'est pas un travail comme un autre. Ce n'est pas suer, arracher, rentabiliser, s'essouffler, souffrir, arraisonner. C'est dialoguer, écouter, proposer, prendre une initiative et écouter la réponse, mêler des rythmes et des logiques différents, faire des expériences et des interprétations, prévoir sans annoncer, viser l'avenir, sachant qu'on ne peut calculer à coup sûr. Sous cet angle dont Adam est le protagoniste sans âge, les notions de propriété et de pénibilité au travail qui ont été historiquement liées au libéralisme doivent être reinterrogées. L'agriculture comme culture de la terre, dont on verra qu'elle est liée à la culture de soi, n'a que très peu en commun avec la production agro-industrielle et l'organisation capitaliste de cette production. Elle s'en distingue comme la subsistance se distingue du profit et souvent s'y oppose, comme la fertilité s'oppose au rendement, comme l'occupation ou la jouissance de la terre se distinguent de son appropriation exclusive, comme le jardinier ou le petit paysan s'opposent à l'agriculteur industriel. Nous n'entrerons pas dans le débat sur les capacités des diverses agricultures à nourrir l'humanité. Il suffira de se rallier au grand concert des analyses percutantes d'un nombre croissant de chercheurs qui non seulement mettent en cause la capacité de l'agriculture industrielle – c'est-à-dire de l'agriculture sans paysans - à le faire, mais aussi dévoilent son rôle plus que néfaste en matière de lutte contre la faim, de souveraineté et de sécurité alimentaires, et de préservation de la qualité nutritionnelle des aliments”.
-Qu’est-ce que donner la parole à ceux qui, par davantage qu’entretien mais présence au paysage, restent gardiens du silence? Qu’est-ce qui dans le silence du paysan fait signe pour une véritable parole?
“Un paysan et une paysanne sont assis, le soir, devant leur maison, tous deux plongés en un long silence; une parole tombe dans le silence, de la bouche de l'homme ou de la femme. Mais ce n'est point une interruption du silence; il semble qu'une parole frappe seulement pour vérifier si le silence est là, puis s'éloigne à nouveau. Ou bien c'est comme la dernière parole qui sort de l'homme afin que le silence soit entièrement présent, la dernière parole court après les autres qui ont précédé et ont disparu: une retardataire qui appartient plus au silence qu'à la parole.
Ce silence des paysans ne signifie pas que la parole ait été perdue, au contraire: en cet état de silence, l'homme se trouve à nouveau au commencement des temps où il attendait de recevoir la parole du silence; il semble qu'il n'ait encore jamais possédé la parole, qu'elle lui soit maintenant donnée pour la première fois. Ce n'est point de l'homme, c'est du silence que la première parole apparaît.Un homme émerge, droit, de la plaine de la terre: on dirait la parole jaillissant de la plaine du silence. Mais aujourd'hui, seul le paysan a encore en lui cette plaine du silence. Le paysan qui émerge, droit, de la plaine du champ, voilà qui correspond à la plaine du silence d'où jaillit la parole de l'homme.”
3)Tetrapharmakon pour la terre.
“Dès la terre” choisit de chercher une origine, un point de départ dans l’espace (l’Europe du sud) pour penser les enjeux climatiques et écologiques en Europe du nord, les moyens de résistance à l’agro-industrie et l’adaptation aux enjeux contemporains. Ce film, en 4 épisodes, propose un voyage dans l’espace et par suite dans le temps, pour comprendre l’agriculture européenne, les solidarités qu’elle implique et la connaissance mutuelle pour défendre un monde commun.
1 - Les difficultés des métiers agricoles face aux changements climatiques et sociétaux
2 - Changer les pratiques, des pistes pour s’adapter
3 - Egalité femme-homme : A quand la fin de l’époque des pionnières ?
4 - Le collectif, un levier de résilience, des fermes aux territoires
1)Lecture de la photographie de Jean Dieuzaide labours à Béost par Marie
2)Lecture par Marguerite du chapitre 6: le paysan et le silence, in le monde du silence Max Picard
Musiques de l’émission:
-Trio Samaïa. lo boïer, traditionnel occitan, 1998.
-Dalida. Salma ya salama, 1977.
Les conseils lecture de dialogues:
-Joëlle Zask, la démocratie aux champs, les empêcheurs de penser en rond, la découverte
- Max Picard, Le monde du silence, la baconnière, 1951
- Artistes et paysans, battre la campagne ,Frac Toulouse, les abattoirs, édition dilecta, 2024
- Nos Espagne(s), Michel Dieuzaide, Cairn, 2025
Les conseils d’exposition
-Du 11 octobre 2025 au 22 mars 2026, Abbaye de Flaran, Gers: la Turquie de Jean Dieuzaide.
-Du 04 juin au 31 décembre 2025, au musée Arts & Figures des Pyrénées Centrales, Saint-Gaudens, Comminges, Michel et Jean Dieuzaide- Nos Espagne(s).
Le Film "dès la terre"
https://youtu.be/K_89RDkKBgA?si=SlGKVQETra5mbQyu
Animatrice: Christine Bessi
Invités: Marguerite Arnedo, Baptiste Dubuet, Julie Poisson et Marie Saliou
Technique: Philippe Donnefort
© Image du podcast Jean Dieuzaide, Labours, 1955-Portugal
Télécharger le podcast





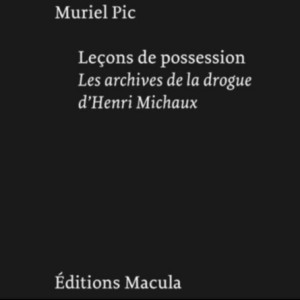

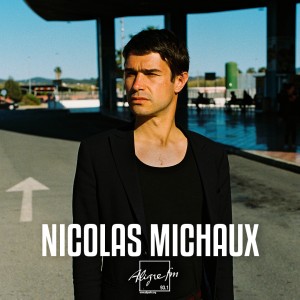













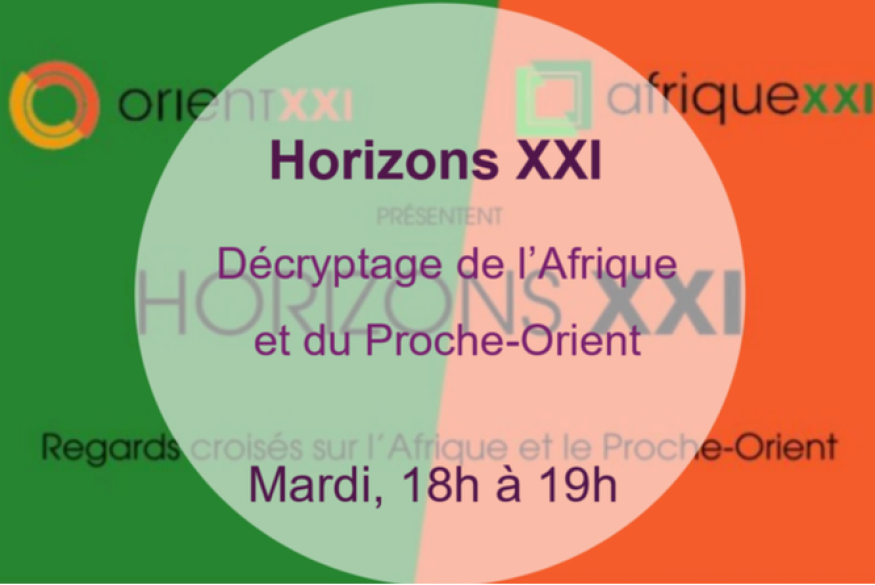








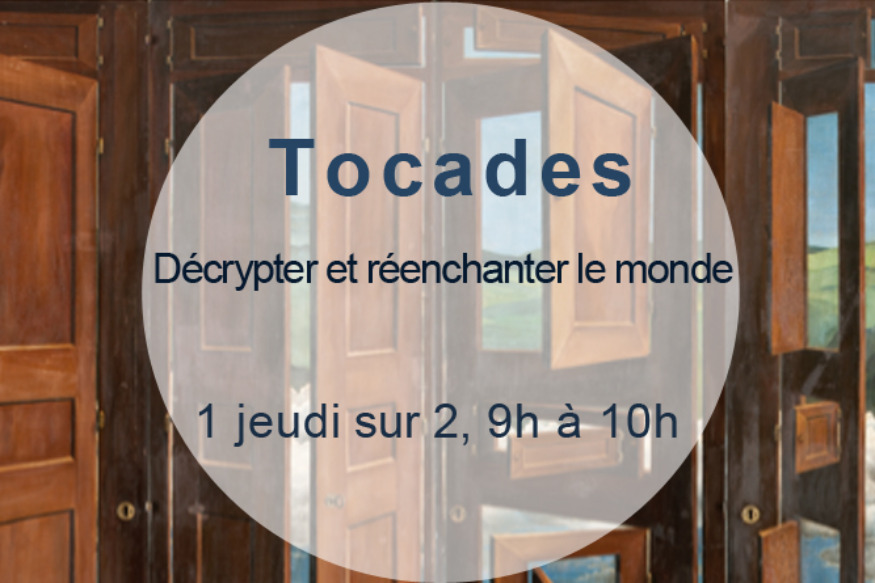

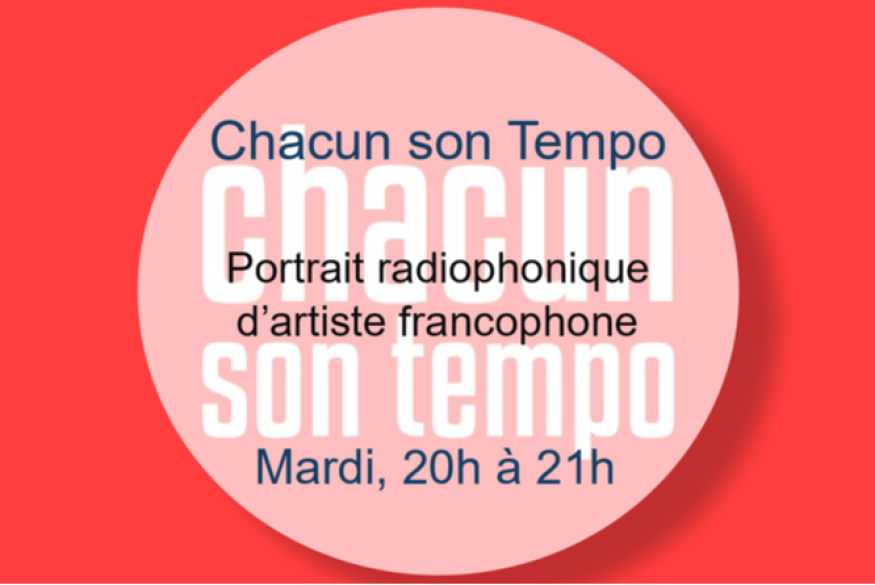





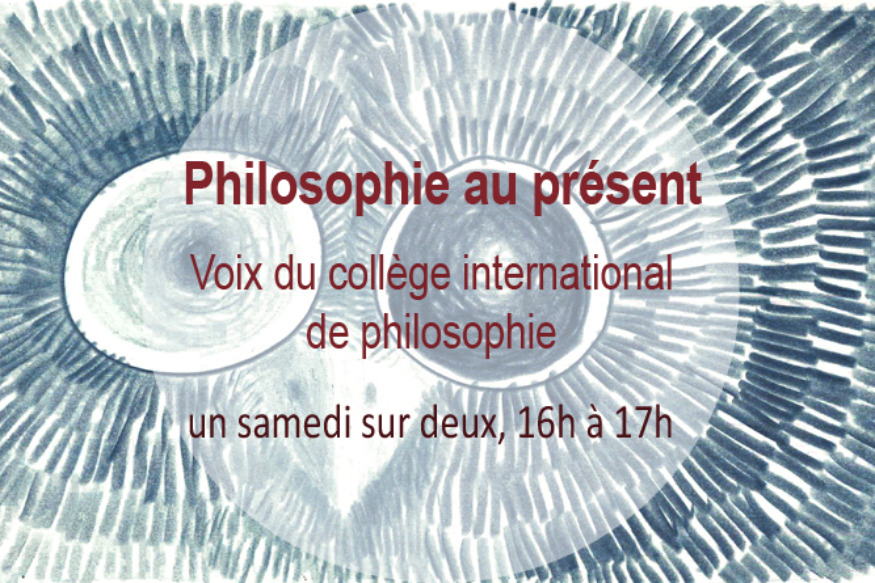














DIFFUSION sur la FM :
Lundi - vendredi : 4h -12h et 17h - 21h
Samedi : 16h - minuit
Dimanche : 00h - 14h et 22h - 4h