Philosophie au présent du 18/10/2025. L’étincelle de l’âme ou l’humilité magnanime dans les tableaux de Georges de la Tour (1593-1652) Une lecture eckhartienne des tableaux nocturnes de G. de La Tour.

L’étincelle de l’âme ou l’humilité magnanime dans les tableaux de Georges de la Tour (1593-1652) Une lecture eckhartienne des tableaux nocturnes de G. de La Tour.
Nathalie Périn reçoit Isabelle Raviolo. Dialogue entre l'animatrice et son intervenante
Introduction : GEORGES DE LA TOUR
- Baptisé en mars 1593 à Vic-sur-Seille en Lorraine, et issu d’une famille de boulangers, Georges de La Tour est le deuxième d’une fratrie de sept enfants ;
- En 1638, un incendie provoqué par les troupes françaises pendant la Guerre de Trente Ans détruit sa maison, son atelier et une partie de ses œuvres. L’artiste trouve finalement refuge à Nancy, avec une partie de sa famille ;
- En 1639, il est nommé « peintre ordinaire du roi » par Louis XIII. À ce titre, il loge au Louvre et est officiellement reconnu par la cour et le milieu artistique parisien ;
- À l’apogée de sa carrière, il peint pour des mécènes prestigieux tels que le cardinal Richelieu ou les ducs de Lorraine, et devient l’un des notables les plus fortunés de Lunéville ;
- Peu de ses toiles sont signées et datées – parmi elles Les Larmes de saint Pierre, 1645, Le Souffleur à la pipe, 1647, et Le Reniement de saint Pierre, 1650 –, ce qui explique qu’il soit rapidement tombé dans l’oubli après sa mort en 1652 ;
- Redécouvert seulement en 1915 par l’historien d’art allemand Hermann Voss, il doit sa « renaissance » à l’étude de deux tableaux conservés au musée d'arts de Nantes : L'Apparition de l'ange à saint Joseph et Le Reniement de saint Pierre.
1. Dans l’intimité de l’œil, au plus profond de l’esprit
Dans cette partie, les raisons d'un dialogue entre Maître Eckhart et Georges de La Tour. Trois siècles séparent ces deux maîtres, mais l’empreinte mystique de leur œuvre les unit.
La Tour n’a très probablement jamais lu le théologien dominicain, mais son travail pictural en est comme l’expression la plus concentrée et la plus énigmatique dans l’histoire de l’art. Par la présence de cette lumière unique à chaque tableau, La Tour peint ce que le prédicateur du XIVème siècle tentait de dire. Ce luminisme virtuose, que le peintre du XVIIème siècle porte à un rare degré de maîtrise, témoigne d’une science de la symbolique lumineuse au service de la mystique, c’est-à-dire de cette réalité invisible qui touche l’union de l’âme à Dieu.
PLAGE MUSICALE 1 : Lacrimosa de Z. Preisner
https://youtu.be/xacflWZig8c?si=qmukhgvXtVWoFQwX
2. Ténèbre et lumière. L’humilité de notre humanité
Dans cette partie, le rapport entre ténèbre et lumière dans le sens d'une relation entre la flamme et l’humilité. C’est peut-être dans le silence du Verbe qu’il faut le chercher, à l’ombre de la Croix : un silence qui nous invite au recueillement, à l’écoute, à l’expérience intime de la présence de Dieu en nous.
De la flamme peinte à la flamme vécue au plus profond de notre être un lien s’établit, une transition s’opère. Si l’ombre envahit la toile, si la mort scelle nos vies, une flamme continue de briller : elle traverse, elle fraie un passage, ouvre un chemin dans un monde intérieur. Elle est promesse de résurrection. L’humilité de l’homme est à l’image de celle du Christ ; elle se dit dans l’obscurité de la nuit, de cette Nuit du Golgotha, mais cette nuit n’est pas la fin, elle est le commencement : commencement d’une vie intérieure, d’une expérience intime d’union au divin. Dans ce fond de l’intime de nous-même, dans ce creuset d’humilité, nous laissons Dieu être Dieu en nous.
PLAGE MUSICALE 2 : Agnus Dei de S. Barber
https://youtu.be/8ZtNWeTypB0?si=aEwEaxBzs-SoDUUn
3. L’incandescence incréée et la beauté de l’âme
Dans cette partie, La Tour est unique dans le paysage pictural de son temps et son œuvre ne s’inscrit pas dans un courant par la place qu’il donne à la lumière artificielle dans ses nocturnes, et au rapport entre la flamme et l’homme. Tout se passe comme si La Tour avait réalisé une œuvre mystique en peinture.
Les nocturnes de La Tour, c’est en eux surtout que se déploie tout le sens caché d’une révélation, et un lien profond entre Dieu et l’âme. Car si La Tour « rend le visible », manifeste la beauté de l’ordinaire, la grandeur des gens simples et des choses précaires, c’est pour dire leur grâce intérieure, l’éclat de leur présence à la lumière de Dieu. La grandeur dont il est ici question renverse notre logique mondaine, nos catégories de réussite et de richesse. C’est une grandeur de l’homme nu, dépouillé, simplifié par l’Esprit de Dieu, qui se révèle à la lueur de la flamme du peintre lorrain. C’est la grandeur de l’homme humble.
PLAGE 3: Symphonie 3 de H. Gorecki.
https://youtu.be/pF3zzi2lseQ?si=WleZoKGDPvDWrC3s
Conclusion : L'obscure clarté. L’espace du dedans
L’œuvre peint de La Tour ouvre l’espace d’un recueillement : regarder un La Tour oblige. Chaque toile est un monde et nous oblige à y être attentif, à développer pour elle une attention hospitalière, capable d’écoute. « L’œil écoute » disait Claudel, et son écoute ici s’inscrit dans un secret, à la lueur d’une bougie.
Notre regard est alors appelé à se déplacer du sens littéral au sens allégorique et du sens allégorique au sens mystique. Regarder un tableau de La Tour c’est comme entrer en relation avec une dimension plus profonde de notre existence, avec cette part intime de notre être que Maître Eckhart appelait « l’étincelle de l’âme » et qui pourrait désigner un état modifié de conscience. Car quelque chose ici se transforme au contact d’un silence qui porte en lui un secret. Nous ne percevons plus seulement des formes, des figures ; nous faisons aussi l’expérience d’une présence : une rencontre a lieu. Par-delà le motif, le sujet profane ou religieux, le tableau semble ouvrir l’œil de celui qui le regarde vers sa profondeur : l’espace d’un dedans, l’antre intime où se vit une rencontre, un dialogue.
Maître Eckart : La voie mystique de Maître Eckhart, dominicain allemand du Moyen Âge, repose sur deux piliers : l’importance du détachement qui permet, par la place qu’il laisse à Dieu dans l’âme, de progresser dans la vie spirituelle ; et la foi en cette certitude que c’est la Trinité tout entière qui vient habiter l’âme de celui qui s’abandonne à Dieu.
Ce que l’on sait de la vie de Maître Eckhart 3 tient en peu de lignes. Né à Hochheim en Allemagne, Eckhart suit des études de théologie à Paris et à Cologne. Entré dans l’ordre des dominicains, il devient prieur d’Erfurt et commence à publier les entretiens spirituels qu’il a avec ses frères de l’ordre.
Après une période d’enseignement à Paris, il est élu provincial de Saxe puis vicaire général de la province de Bohême et enfin de Teutonie. Mais il est surtout un maître spirituel influent et reconnu. Pour de sombres questions internes à l’ordre des dominicains, il a maille à partir avec l’Inquisition. La raison invoquée pour sa mise en accusation est l’influence supposée de certaines de ses propositions sur les béguines, ces femmes mystiques caractéristiques de la vie spirituelle du Moyen Âge rhénan.
Une influence considérable. Condamné par le pape Jean XXII, il réfute les accusations portées contre lui mais meurt néanmoins dans l’isolement le plus complet, au point que l’on ignore la date précise de son décès. Son influence est cependant considérable par la vigueur de sa pensée et la profondeur du cheminement spirituel qu’il propose.
Père de la mystique rhénane. La voie mystique de Maître Eckhart repose sur deux piliers : le premier est l’importance du détachement qui seul permet, par la place qu’il laisse à Dieu dans l’âme, de progresser dans la vie spirituelle, le second est la foi en cette certitude que c’est la Trinité tout entière qui vient habiter l’âme de celui qui s’abandonne à Dieu. Le style littéraire de Maître Eckhart est particulièrement suggestif. Il utilise de nombreux paradoxes qui, en forçant sa pensée, font image pour le lecteur.
Il est considéré comme le père de la mystique rhénane, un des courants spirituels les plus importants de la spiritualité chrétienne. Maître Eckhart a en effet inspiré des penseurs comme Henri Suso, Jean Tauler, Nicolas de Cues, Jan de Ruysbroek. Redécouvert au XIXe siècle, il est peu à peu vulgarisé et se trouve aujourd’hui particulièrement apprécié par ceux qui cherchent une voie mystique radicale et contemporaine.
Télécharger le podcast





















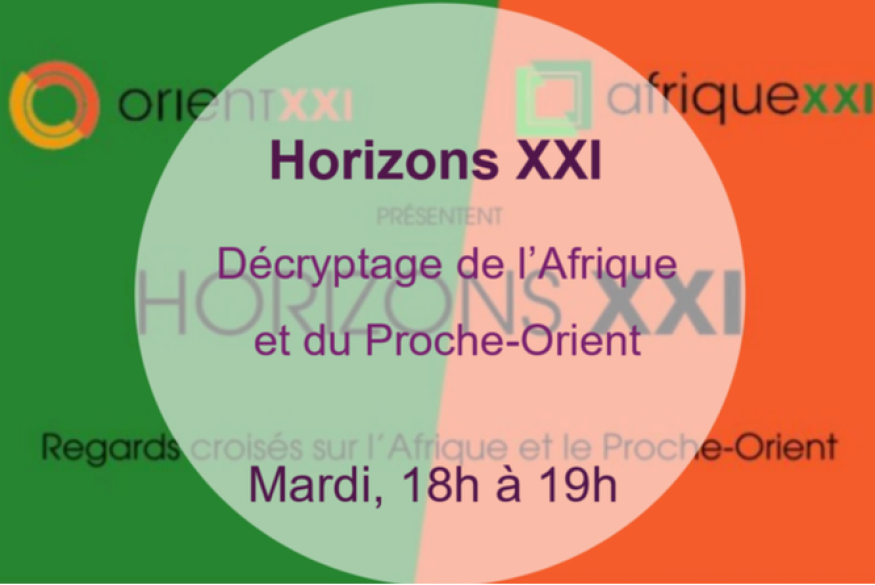








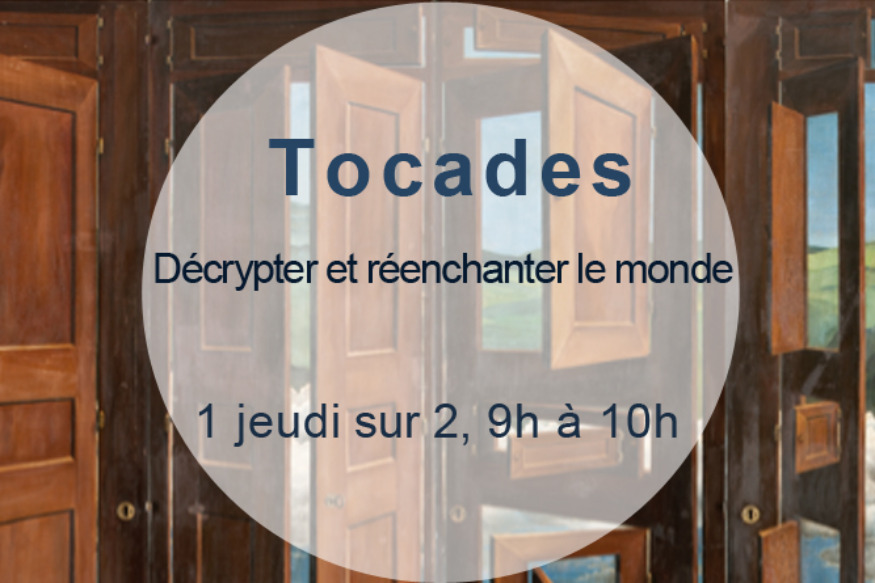

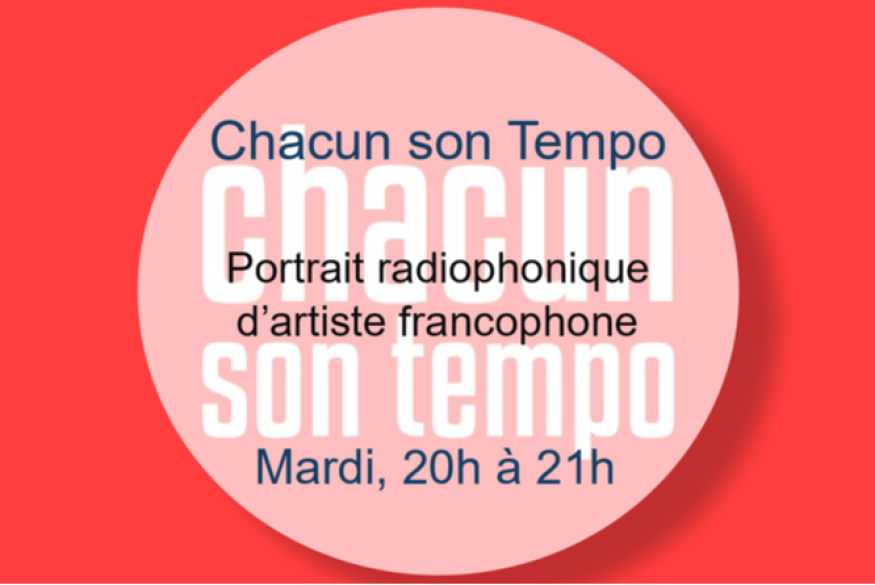





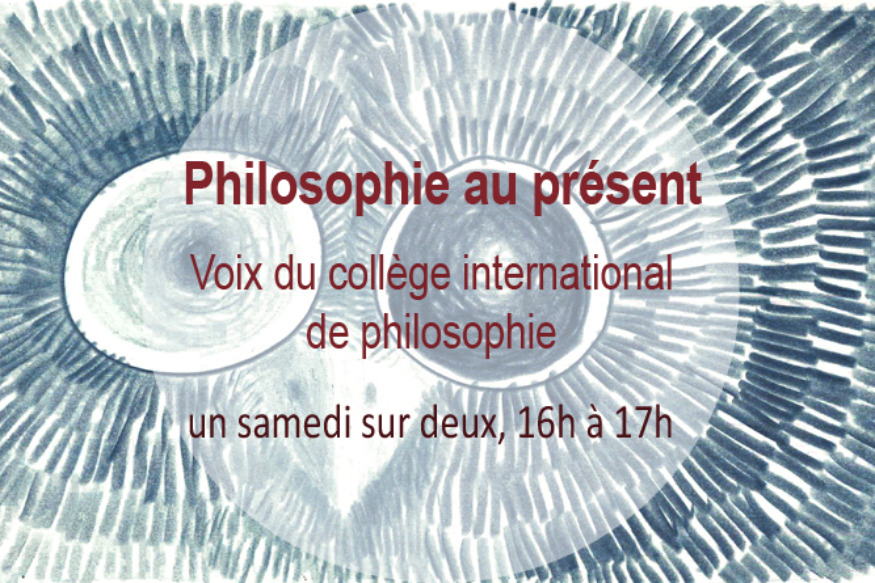














DIFFUSION sur la FM :
Lundi - vendredi : 4h -12h et 17h - 21h
Samedi : 16h - minuit
Dimanche : 00h - 14h et 22h - 4h